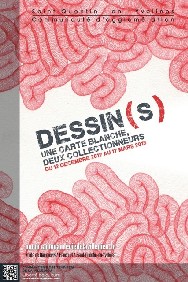|
Le poil à gratter…
|
|
Les dessins d’Emmanuel Rivière |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
On connaît peu la pratique du dessin chez Emmanuel Rivière. Elle demeure son jardin secret, une forme d’exutoire à la production d’œuvres en trois dimensions. Quand le sculpteur doit déployer des gestes amples, occuper les trois dimensions d’un espace potentiellement illimité, manipuler, soulever, déplacer des pièces souvent lourdes, le dessinateur, lui, reste dans un univers bidimensionnel, avec des mouvements mesurés, confinés dans les dimensions bornées de la feuille. Emmanuel Rivière accentue encore ce contraste en pratiquant le dessin sur une planchette de bois, placée sur ses genoux, sur des feuilles dont les dimensions n’excédent pas celle du format raisin. Un espace normé, à l’échelle de son corps : la longueur de son bras, la largeur de quelques mains. Il alterne ces phases de tension, de contraction introspective, de repli, avec d’autres de détente, debout, recourant à un chevalet où la feuille, toujours de petit format, est calée verticalement, l’artiste reculant et avançant pour juger de l’équilibre de la composition, de ses manques et de ses zones de saturation. Dans ses œuvres sur papier, Emmanuel Rivière se défie des pièges de la virtuosité. Pour s’en prémunir, il s’impose des contraintes, feint la maladresse… La première de ces contraintes est celle de la posture. Dessiner sur ses genoux, penché en avant, avec un support instable, sur une feuille aux dimensions restreintes, met d’emblée un frein à tout geste ample, libre, incontrôlé. C’est obliger à l’introspection, c’est tuer dans l’œuf toute velléité d’emphase ou d’affectation, de grandiloquence ou d’hyperbole. Le dessin vient alors du dedans, du dessous, de l’intérieur, de l’intime. Il émerge du fond – de la feuille et du subconscient – plus qu’il ne concrétise, ne projette ou ne finalise une idée générale, un geste avec une quelconque prétention à une portée universelle. Pour tracer ses lignes, Emmanuel Rivière arme sa main de plusieurs crayons, un peu à la façon dont les cancres, de mon temps, usaient de porte-plume à plusieurs plumes pour copier leurs lignes de punition. [1] Il en résulte des irrégularités, des maladresses, savamment dosées, dans le parallélisme, des retards ou des avances d’une ligne par rapport à ses voisines, des virages serrés, d’autres plus larges… On pense à ces modernes charrues à plusieurs socs[2] qui creusent simultanément plusieurs sillons, grossièrement identiques et parallèles, mais dont l’aspect change avec la nature du sol. Il en est de même des traits des dessins d’Emmanuel Rivière, qui réagissent à la texture, à la résistance, à l’élasticité, aux imperfections du papier et de la planche qui le supporte. Avec une différence majeure, cependant : Emmanuel Rivière pousse et tire alternativement ses crayons, alors que les boustrophédons de la charrue ne résultent que d’un effet de traction. Les dessins d’Emmanuel Rivière jaillissent donc de la confluence de deux flux d’énergie : celle, active, de la volonté de l’artiste, même si elle se manifeste sous contraintes, et celle, passive, réactive, souvent imprévisible, du support et de ses accidents. Les différences des mines des crayons ajoutent à la surprise. Il en est de dures et acérées, qui incisent presque le support, des douces et duveteuses, qui s’épanchent dans des contours imprécis, des traits d’un noir profond, des gris indécis, d’autres avec des reflets bleus quand on les regarde latéralement et, parfois, quelques rares incursions de sanguine. Le trait nerveux et partiellement sujet à des aléas peut faire penser à des relevés sismographiques, [3] à la superposition de tracés d’électro-encéphalogrammes, à des coupes histologiques, à des stratifications géologiques, à des paysages de montagne avec leurs lignes de crête, aux veines de planches de bois, aux vagues de la mer, aux jeux de la lumière sur un plan d’eau… C’est que l’on a naturellement tendance à lire ces dessins horizontalement, à l’italienne, mais rien n’interdit de les faire pivoter de 90°, en format portrait. On découvre alors d’autres images, d’autres lectures. Certaines feuilles évoquent alors l’émergence, le jaillissement du blanc par derrière, de la lumière, dans les peintures de Barnett Newman, d’autres l’obsession de la ligne nerveuse et faussement tremblante de Gilgian Gelzer, ailleurs encore les baigneuses sous des cascades de Tal-Coat, là où chevelures et filets d’eau deviennent indissociables. [4] Dans les deux cas, le geste semble se poursuivre au-delà du champ délimité par les bords de la feuille, dans une forme de all-over qui récuse à la fois la répétition et l’auto-similarité. En l’occurrence, il s’agirait plutôt d’un fragment d’un tout, d’un cadrage d’une fraction d’un paysage mental qui, telle une parcelle d’un hologramme, serait potentiellement porteuse de la totalité de l’image. On pourrait aussi évoquer la manifestation de ces homothéties internes génératrices de fractales. Dans la plupart des dessins d’Emmanuel Rivière, deux flux, deux coulées[5] se superposent, avec des angles plus ou moins ouverts. Ceci a pour effet de conférer au dessin une profondeur, une troisième dimension qui ne doit rien aux artifices des lois de la perspective. Quand l’angle des deux flux est très ouvert, des effets d’interférence et de battement animent la surface, au point de donner l’illusion d’un mouvement. Quand l’angle est plus ouvert, c’est de la profondeur de champ qui apparaît. Le parallélisme avec l’écriture musicale est flagrant : mélodique en horizontale, harmonique en verticale. Avec une simple rotation de la page pour intervertir les rôles, ce que nulle partition musicale ne saurait produire… Louis Doucet, novembre 2012
[1] De fait, la manipulation de cet outil était tellement complexe que l’exercice prenait plus de temps que la copie desdites lignes avec une seule plume. De plus, l’instituteur était rarement dupe et doublait en général la punition en mesure de rétorsion.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Un chef-d’œuvre revisité |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mais pourquoi donc l’Olympia de Manet, réalisée en 1863 et exposée pour la première fois en 1865, fut-elle l’objet d’un scandale sans égal ?
Ce n’est certainement pas la figuration de la nudité : les cimaises du Salon officiel en étaient recouvertes. Il est vrai que, pour préserver la fausse pudibonderie de l’époque, les nus étaient soigneusement épilés et usaient de prétextes historiques, mythologiques, exotiques ou chrétiens pour se justifier. Combien de jeunes saintes nues jetées en pâtures aux bêtes féroces dans l’arène, de belles nudités libérées par des preux chevaliers terrassant un dragon ou d’odalisques se préparant dans un harem ? Le personnage de Manet ne répond pas à ces critères. C’est, très clairement, une prostituée qui attend son client… Le spectateur ? D’ailleurs, dans les années 1860, le mot olympia était couramment utilisé pour désigner les putains de luxe. Cézanne, dans les deux versions de son Une moderne olympia, enfonce le clou en mettant en scène le client, presque à la place du spectateur. Le châle jaune sur lequel le modèle repose était aussi un des attributs de cette profession. [1] Ce n’est pas la pose, non plus. Elle est plutôt moins lascive que celle des modèles empruntés à ses illustres prédécesseurs : la Vénus de Dresde de Giorgione, la Vénus d’Urbino du Titien, l’Odalisque à l’esclave d’Ingres, la Maja Desnuda de Goya… Cette dernière est bien plus provocatrice : pas de main pour dissimuler un pubis où l’on distingue l’ombre d’une toison… Il y a aussi, chez Manet, le chat noir (sournoiserie et féminité) à la queue dressée, qui remplace le chien (fidélité) endormi du Titien, métaphore limpide pour le minou que dissimule la main. La servante noire n’est pas plus insolite que ne le sont la servante jouant du luth et l’eunuque noir chez Ingres. Notons, cependant, que chez ce dernier, la couverture bleue sur laquelle est allongée l’odalisque révèle un coin de sa doublure… Jaune… Lourd de sens : sous le couvert de la pureté (bleue) se révèle la putain (jaune). Une conception bien machiste et XIXe siècle de la femme… Ne serait-ce pas là qu’il faut chercher ce qui dérange dans ce tableau ? Chez tous les précurseurs de notre Olympia, le modèle est passif – il a même les yeux fermés, chez Giorgione –, offert à la lubricité du spectateur mâle. Chez Manet, le modèle, clairement individualisé, dans une lumière crue, regarde fixement le spectateur. L’absence d’expressivité et de sensualité dans le rendu des chairs[2] montre que le propos de l’artiste n’est pas de produire une œuvre émoustillante, mais bien ailleurs. Il s’agit d’une confrontation, d’une situation de conflit, dans laquelle la femme est sur le point de prendre le dessus ou, plutôt, l’initiative. Elle n’est plus neutre et passif objet de désir, mais être doué d’une personnalité active, revendiquant son droit au plaisir et sa domination sexuelle sur l’homme qui devient son jouet. Inadmissible, dans la société du XIXe siècle… Mais ne l’est-ce pas encore aujourd’hui chez beaucoup de nos contemporains ? C’est dans cette affirmation féministe avant l’heure que l’Olympia de Manet, nous interpelle et nous interpellera donc longtemps. Elle répond encore et toujours à la devise que le peintre s’était forgée : manet et manebit. [3] Louis Doucet, décembre 2012
[1] Véronique Bui, Le châle jaune des prostituées au XIXe siècle : signe d’appartenance ou signe de reconnaissance ?, association Fabula, février 2008.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Nathalie Da Silva
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nathalie Da Silva pratique essentiellement le dessin, sur des feuilles de grandes dimensions. Son inspiration prend source dans la nature, une nature domestiquée, celle des paysages urbains, le plus souvent : parcs, jardins, espaces publics… Elle photographie des fragments, fait des croquis sur le motif ou de mémoire, puis travaille les images résultantes sur ordinateur, en noir et blanc, pour les réduire à des formes essentielles, planes, frontales, constituées de plages saturées, percées de trouées de lumière, souvent structurées en grilles orthogonales. Son travail de déconstruction s’arrête au seuil où la forme originelle risquerait de perdre son identité, de devenir méconnaissable, un peu à la façon dont un idéogramme chinois synthétise un objet, n’en gardant que les contours essentiels, pour produire un archétype irréductible sous peine de perdre son sens. Nathalie Da Silva projette ensuite la forme obtenue sur une feuille de papier, l’agrandissant avec un épiscope. Suit un long et minutieux travail de crayonnage visant à colorier les zones sombres. Le geste de remplissage, quasi obsessionnel, s’applique à varier les entrelacements des traits de la mine colorée pour produire une texture sensuelle, vivante, végétale dans son aspect, appelant une appréhension tactile que la planéité du support dénie et dément dans le même instant. La monochromie est de rigueur, avec une évidente volonté de distanciation par rapport aux couleurs du modèle initial. Si le vert est souvent utilisé, il l’est presque par accident, sans référence aucune aux colorations de la nature. D’ailleurs, le bleu, le rouge, le gris ou l’orange peuvent le remplacer sans que le caractère de la composition en soit altéré. Plus récemment, Nathalie Da Silva a introduit la polychromie dans certains de ses dessins, mais les couleurs ne se mêlent pas, chacune se voyant confier un quadrant de la composition. Le refus d’un naturalisme littéral, de tout symbolisme, de tout pathos ou de toute revendication psychologique ramène le dessin à sa seule matière, à son essence même, à sa présence ontologique, transposant ainsi pour son compte la définition que Maurice Denis donnait de la peinture : « une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. » Le dessin, devenu langage, gagne ainsi son autonomie par rapport à son thème générateur, tout en contenant une capacité génésique, celle de reproduire une structure rhizomatique envahissante, à la manière des végétations luxuriantes. Les dessins, accrochés au mur, presque de plain-pied, se présentent comme de vastes portiques conviant le spectateur à les pénétrer, tout en jouant sur l’ambiguïté d’une représentation délibérément bidimensionnelle invitant, cependant, à entrer dans une troisième dimension préalablement anéantie. Louis Doucet décembre 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Quelques acquisitions récentes |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
À ne pas rater... |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Samuel Aligand • Anne-Sophie Atek • Erwan Ballan • Pascale Baud • Élise Beaucousin • Maya Benkelaya • Ode Bertrand • Lucie Bitunjac • Elvire Bonduelle • Philippe Boutibonnes • Élodie Boutry • Claude Briand-Picard • Vincent Bullat • Benoît Carpentier • John Casey • Claude Cattelain • William Chattaway • Guillaume Constantin • Flavie Cournil • Nathalie Da Silva • Frédéric Daviau • Davmo • Dominique De Beir • Raffaella Della Olga • Diogène • Dirk Dombrowski • Marine Duboscq • Thomas Egeler • James Fancher • Jean-Louis Gerbaud • Hermann Geyer • Gilles Guias • Cristine Guinamand • Sylvie Guiot • Alexandre Hollan • Djoka Ivackovic • Marion Jannot • Marine Joatton • Daniel Johnston • Jean-Luc Juhel • Wolfram Kastner • Frank Kienberger • Maëlle Labussière • Jérémy Laffon • Max Lanci • Peter Max Lawrence • Guy Le Meaux • Christian Lefèvre • Frédérique Loutz • Dominique Lucci • Frédéric Magnan • Philippe Martinery • Ronald Mauthe • John McLaughlin • Jean-Michel Messager • Jürgen Meyer • Olivier Michel • Jean Boskja Mißler • Johannes Möstl • Franck Mouteault • Knut Navrot • Michel Nedjar • Richard Negre • Soeren Neuperti • Patrice Pantin • Manuel Parrès • Christian Paulsen • Antoine Perrot • Anna Picco • Pascale Piron • Charlotte Puertas • Michel Raba • Pierre-Alexandre Remy • Anne Marie Rognon • Frank Schwarzinger • Elmar Seifert • Nicolas Simonin • Jack Skysegel • Anne Slacik • John Christoph Dionysos Sommersberg • Pierrick Sorin • Emma Souharce • Michael Stilkey • Michel Suret-Canale • Abdelkrim Tajiouti • Alain Trez • Christèle Veaux • Cécile Wautelet • Karl Friedrich Elias Weisgärber • Gernot Wieland • Karolina Zalewska
|
|||||||||||||||||||||||||||
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2013
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre