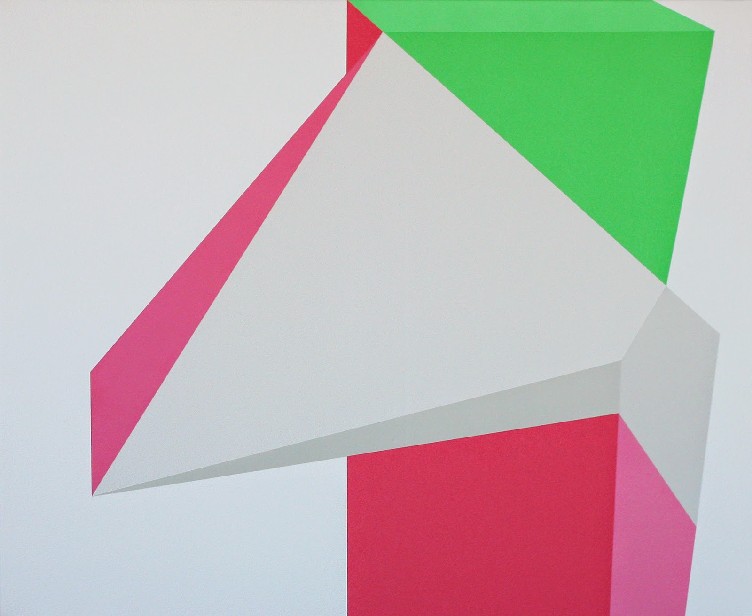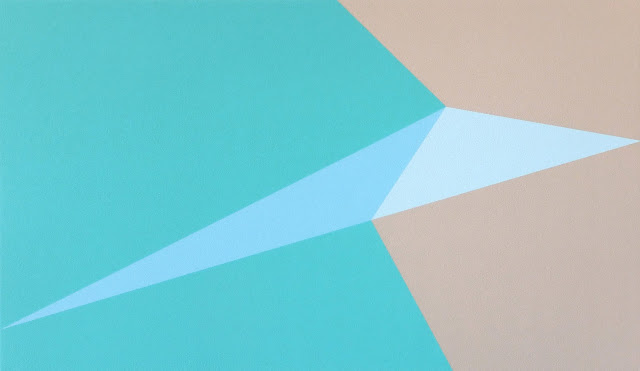|
Le poil à gratter…
|
|
Oscar Malessène |
|
|
|
Le Temps est l’image mobile de l’immobile Éternité. Les peintures d’Oscar Malessène s’inscrivent dans la grande tradition de l’abstraction géométrique. Elles prennent cependant leurs distances avec les canons posés par les fondateurs de ce mouvement mais aussi avec les productions de ses contemporains. En effet, en opposition frontale avec les préceptes édictés par Mondrian, Oscar Malessène se complaît dans les structures obliques, pas plus qu’il ne bannit la couleur verte. Ce n’est pas non plus chez Van Doesburg qu’il faut rechercher ses sources, car son répertoire chromatique est nourri de demi-teintes claires, tendres, pastellisées coexistant avec les couleurs primaires. Quant à ses diagonales elles ne structurent pas le plan mais s’appuient, tout en les dévoyant, sur les leçons de la perspective albertienne. C’est donc ailleurs qu’il faut diriger la recherche en paternité. Ses compositions aux couleurs inexorablement délimitées, en aplats, se développent en séries dans lesquelles chaque tableau paraît proposer une réponse plastique à la question du rapport de la ligne au plan. Les écrits théoriques de Kandinsky, notamment Punkt und Linie zu Fläche,[1] semblent donc avoir inspiré sa démarche, mais Oscar Malessène en tire des conclusions plus radicales que celles du maître du Bauhaus. Il ouvre notamment les portes vers la troisième dimension, l’espace, en mettant en scène des volumes assemblés dans des combinaisons perspectives paradoxales. Tel ensemble de plans colorés suggérera une forme qui sera alternativement perçue comme devant et derrière sa voisine, laquelle générera, à son tour, cette indécision, entraînant le spectateur dans un tourbillon qui prélude au vertige. Pourtant, les surfaces clairement démarquées, les couleurs méticuleusement appliquées relèvent plus des pratiques d’un bureau d’architecture que de celles d’un peintre. Mais il s’agit ici de l’œuvre d’un architecte qui privilégierait le rythme, ce rythme dont Yves Bonnefoy déclarait : « Le rythme ressemble au temps, à la fois un et changeant, il ressemble à l’architecture, c’est-à-dire à notre univers qui est une construction. »[2] Point, ligne, plan, espace (Raum), temps (Zeit)… Chez Oscar Malessène, le propos de Kandinsky s’élargit donc à deux dimensions supplémentaires… Peut-être faut-il chercher du côté du kaléidoscope, dont Jonathan Crary a magistralement mis en évidence l’importance pour l’éducation du regard à la modernité dans le cours du XIXe siècle.[3] Ou, plus spécifiquement encore, chez Robert Delaunay et ses fenêtres prismatiques simultanées, avant qu’il ne se voue aux formes circulaires. Peut-être aussi chez Larionov avec ses agencements anguleux de formes éclatées et de couleurs réfractées par un prisme… Chez Oscar Malessène les surfaces colorées sont les éléments de base d’un alphabet formel qu’il ordonne et assemble dans des constructions portant chacune leur logique mais qui constituent, d’une peinture à l’autre, un immense exercice de variations sur un schéma génésique prédéfini, lequel ne pourrait s’éteindre que quand toutes les combinaisons plastiquement viables auraient été épuisées. On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec un des propos de l’éminent linguiste Georges Mounin : « Une langue est un prisme à travers lequel ses usagers sont condamnés à voir le monde. »[4] Et le monde que la langue créée par Oscar Malessène nous donne à voir est aussi paradoxal et insaisissable que les images d’un kaléidoscope… Un et changeant selon Mounin, mobile et immobile, selon Platon… Le chemin tracé par Oscar Malessène est celui d’un sentier de crête, entre deux ravins également dangereux et menaçants. D’un côté, celui de la répétition froide et mécanique de formules éculées dont la prédictibilité est celle d’équations programmables produisant ad nauseam les mêmes banalités tautologiques, ces propos pompeux sur la peinture et sur son rôle, dans une réflexion qui ignore le monde environnant. De l’autre, celui d’une joliesse superficielle, flatteuse pour le regard, séduisante, aguichante, mais désespérément vide de sens et d’espoir. Ce chemin difficile, sur le fil du rasoir, est celui qu’évoque le grand écrivain polonais Stefan Żeromski : « La limite entre le mal et le bien est aussi mobile et instable qu’un sentier de crête en craie fondante. »[5] Et les couleurs de cette craie fondante ne sont-elles pas celles-là mêmes qu’Oscar Malessène nous offre par la magie de sa somptueuse alchimie ? Cette tension dialectique, cet état d’instabilité essentielle, indispensable à la formulation de tout discours pertinent, est évidente dans le contraste entre les formes acérées des polygones et la douceur modérée de certaines de leurs colorations qui coexistent avec des tonalités primaires plus franches et un large spectre de gris… Entre les délimitations rigoureuses, nettes et précises des surfaces et l’instabilité des perspectives qu’elles engendrent… Entre la simplicité des moyens mis en œuvre et le vertige perceptif qu’ils éveillent… Entre l’inscription dans un mouvement ancré dans une histoire bien établie et les libertés transgressives prises avec cette même tradition… Entre puritanisme hard edge et préoccupations expressives… Entre dissonances des couleurs prises deux à deux et harmonie de l’ensemble… Les prismes trompeurs d’Oscar Malessène ne seraient-ils pas de même nature que les larmes qu’évoque François Coppée ? L’eau d’une larme est un prisme Il me semble qu’une autre préoccupation hante Oscar Malessène, celle de la combinatoire, de la variation, au sens musical de ce terme. Dans un effort, qu’il sait pourtant désespéré, il tente d’épuiser le champ des possibilités plastiques offertes par la juxtaposition de quelques formes géométriques simples sur une surface plane. Mais il le fait sans jamais sombrer sur le récif de la déclinaison déshumanisée d’algorithmes trop prévisibles. Chaque nouvelle peinture d’une série est à la fois clairement inscrite dans la continuité des précédentes et s’en distingue d’une façon unique. Elle tient indépendamment de celles qui l’ont précédée et de celles qui la suivront. Plus que de la musique, ces variations relèvent, pour moi, des gammes plastiques du Piranèse dans les planches de ses Prisons ou, peut-être plus encore, des préoccupations de Beckett dans Le dépeupleur. Tout comme l’écrivain franco-irlandais, Oscar Malessène retravaille inlassablement son jeu de variations pour mettre en évidence l’inépuisable champ combinatoire offert par un motif élémentaire potentiellement aride… Et l’ouvrage se termine sans s’achever, sans réussir à épuiser les possibles de sa signification : « […] le peu possible là où il n’est pas n’est seulement plus et dans le moindre moins le rien tout entier si cette notion est maintenue. Et les yeux soudain de se remettre à chercher aussi affamés que l’impensable premier jour jusqu’à ce que sans raison apparente brusquement ils se referment ou que la tête tombe. »[7] Et nous, pauvres chercheurs, sommes condamnés à ne rien trouver : « Quoi qu’ils cherchent, ce n’est pas ça. »[8] Une image en abyme de la posture du regardeur ou du critique quand il tente, par des échelles conceptuelles, d’accéder à des niches pour y ranger des interprétations, alors que l’œuvre se refuse à toute lecture réductrice. Même si l’on sait bien que l’esprit humain est fait de telle façon qu’il ne peut se résigner à cet échec… Louis Doucet, janvier 2017
[1] Point Ligne Plan, le numéro 9 des Bauhausbücher, 1926.
|
|
Jérôme Legrand |
|
|
|
Il faut rendre manifeste ce qui est caché, et occulte ce qui est manifeste. Apocalypse ou épiphanie ? En rapprochant ces deux mots, il n’est pas question d’une catastrophe aussi inéluctable qu’imminente ni d’une joyeuse fête avec galette et fèves. Il s’agit, ici, de prendre ces termes dans leur sens premier, étymologique, respectivement révélation et manifestation… Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans la peinture de Jérôme Legrand… Du moins du point de vue du spectateur… Pour notre peintre, il en va autrement. Il superpose, sur ses toiles, des couches liquides, plus ou moins translucides, qui masquent partiellement les précédentes, ne laissant subsister que quelques plages préservées de l’occultation, comme autant d’étocs dans un océan de matière picturale. Hasard objectif au sens où Breton l’entendait (« la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un chemin dans l’inconscient humain »[2]) ou non ? La question reste ouverte… Ce qui est certain, c’est que, nappe fluide après nappe fluide, couche après couche, se crée une profondeur qui n’a rien de celle de la perspective illusionniste traditionnelle. Le peintre devient ainsi, si l’on en croit l’alchimiste[3] du XVe siècle, un sage, puisqu’il manifeste (épiphanie) ce qui est caché et nous cache une partie de ce qui est manifeste. On peut considérer aussi que son geste, son action, miroir de sa personnalité, serait, à son tour, une autre forme d’épiphanie. Du moins si l’on suit Jacques Maritain quand il écrit « L’action est une épiphanie de l’être ».[4] Si le peintre procède en construisant la toile du fond vers la surface, l’œil du regardeur, lui, va de la surface vers le fond. Son expérience est donc autre. C’est celle d’une révélation (apocalypse) progressive – et nécessairement partielle – de ce que l’artiste a déposé dans les couches successives de son œuvre. À rebours du peintre, le spectateur se trouve placé dans une position de voyeur, tentant de distinguer ou de deviner ce que le plasticien veut lui cacher. À son insu, il est amené à déplacer son point d’observation et à tenter d’analyser la peinture depuis son arrière vers son avant, travail d’archéologue le poussant à essayer de retrouver l’être agissant – le peintre – à partir de ses traces… Et peut-être que, finalement, il n’y a rien d’autre à découvrir que de l’invisible. Ces toiles pourraient donc donner raison à Anaxagore qui déclarait : « Tout ce qui se manifeste est vision de l’invisible. »[5] Plus encore, elles soutiendraient la pensée de ce philosophe présocratique selon laquelle l’intellect est la seule cause de l’univers…[6] De l’univers pictural, à tout le moins, dans le cas présent… Jérôme Legrand ne s’en cache pas, d’ailleurs : « Le sujet n’existe pas, c’est ma propre respiration, et mon humeur qui me dictent le souffle, le rythme, le ton. »[7] Plus que d’une asymétrie du regard, je pense qu’il faut plutôt parler de semi-perméabilité de la matière picturale. L’image du moucharabieh dans l’architecture traditionnelle des pays arabes s’impose avec force. Apporter un air rafraîchissant, permettre de voir sans être vu… Les toiles de Jérôme Legrand ont ces caractéristiques, surtout celles dont la couche la plus superficielle est blanche, évoquant un éternel printemps jaillissant de l’emprise glacée de l’hiver. L’ancrage architectural est parfois souligné par une bande monochrome verticale au bord gauche de la toile. On peut aussi y voir la marque d’une reliure incitant à tourner la couverture pour pénétrer dans un livre dont le contenu reste définitivement inaccessible. La dimension musicale est aussi très présente dans la mise en page des peintures. On y lit des tensions, des détentes, des strettes, des développements, des variations, des modulations, des changements de mode chromatique, du mineur au majeur et vice-versa. Visuellement, certaines toiles se présentent d’ailleurs comme des pages de partitions musicales. J’y retrouve certaines feuilles du manuscrit de la troisième sonate pour piano de Pierre Boulez et, plus encore, des Archipels d’André Boucourechliev. La notion d’archipel est d’ailleurs très intimement liée à la peinture de Jérôme Legrand, avec son humidité ambiante et ses émergences de reliefs enfouis comme autant d’îlots, de récifs, d’accidents qui accrochent et retiennent le regard… Pour le faire sombrer… Le chant des Sirènes… Jérôme Legrand n’est pas un débutant dans le monde de la peinture. Il la pratique depuis plusieurs décennies, avouant, non sans humour : « Je peins pour le plaisir, par nécessité, car c’est ce que je sais faire de mieux. »[8] Sa peinture a été souvent vue à Paris et ailleurs. Inutile, cependant, de tenter d’en trouver trace sur google… Sa nouvelle identité est un pseudonyme, transparent pour qui suit son travail depuis les années 1990, opaque pour ceux qui le découvriront… Opacité et transparence… Cacher pour mieux révéler… Révéler pour manifester une vérité occultée… C’est bien tout l’enjeu de sa peinture. Louis Doucet, janvier 2017
[1] Bernard Le Trévisan (1406-1490), in Trevisanus de Chymico miraculo, quod lapidem philosophiae appellant, édité en 1583 par Gerard Dorn.
|
|
Quelques acquisitions récentes |
|
|
|
|
|
À ne pas rater... |
|
|
|
|
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2017
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre – Ne plus recevoir la lettre