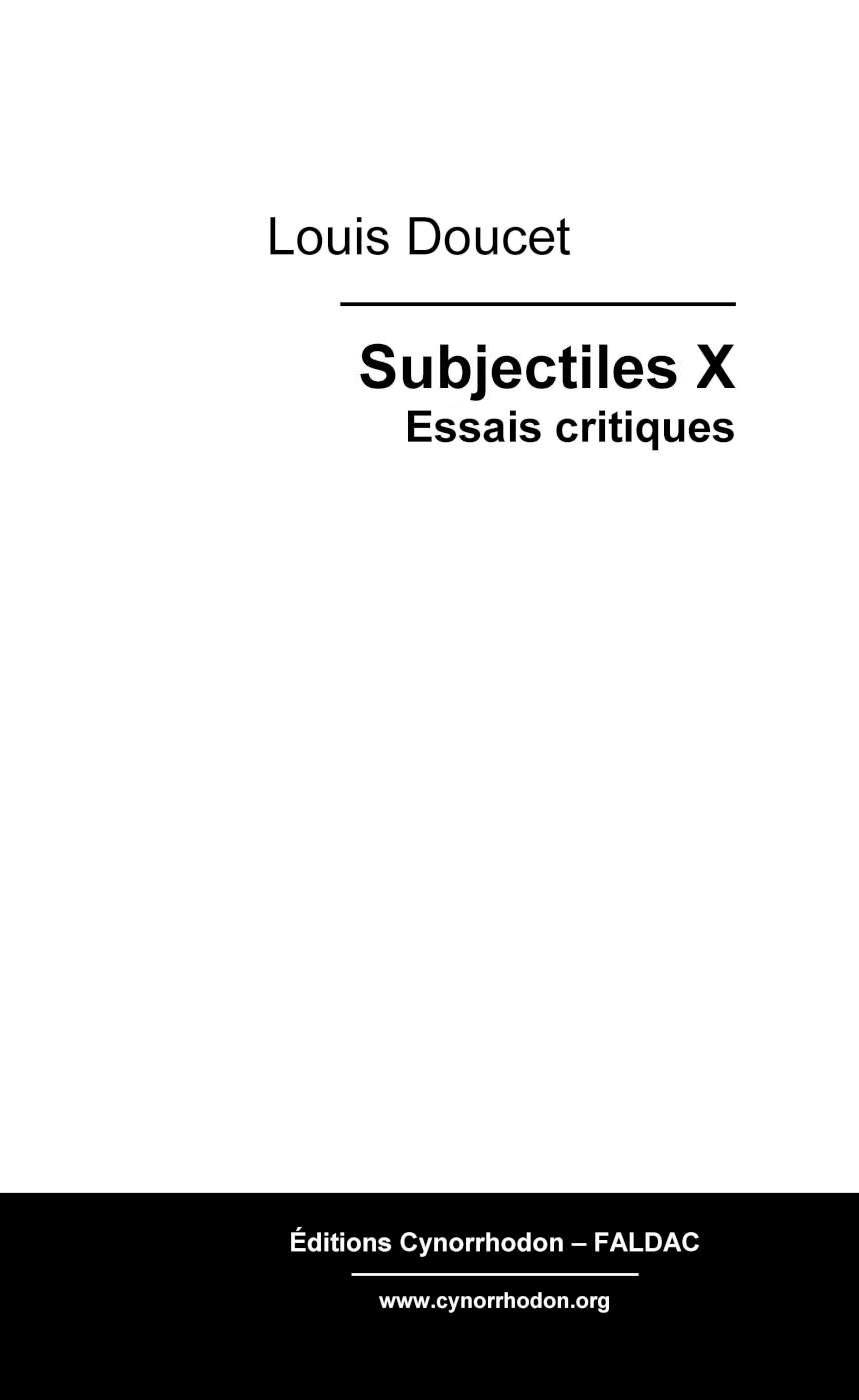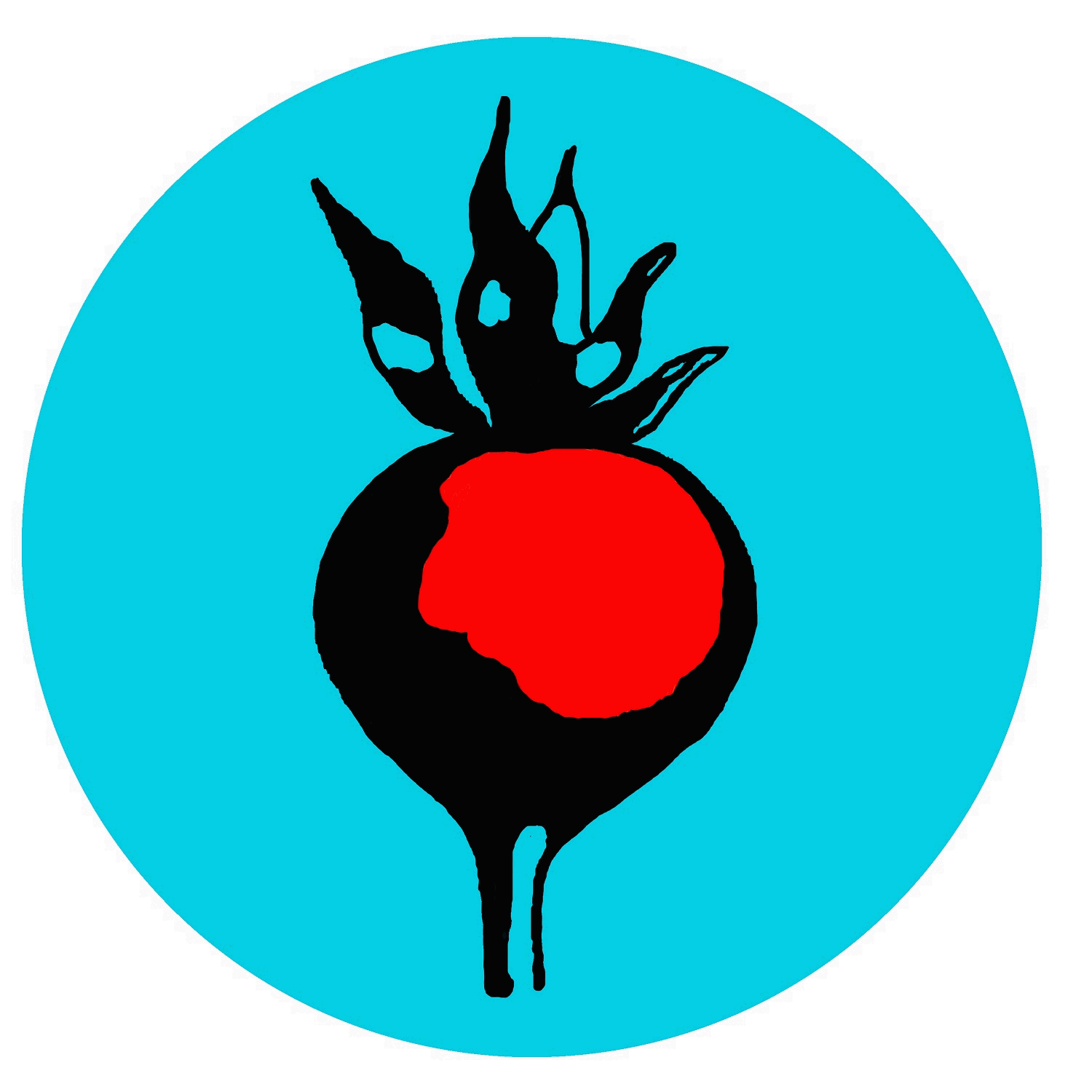|
Le poil à gratter…
|
|
Jean-Louis Gerbaud – Au cœur de la peinture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[…] l’effort fondamental est d’approcher ce qui nous rend le monde perceptible. j’entends la lumière qui est là avant tout discours, toute possible identification, est avant que nommée ! […] je ne fis jamais [d’œuvre] qui procédaient de l’imaginaire et non plus ne me sentis réduit à l’en-face, mais dans, débordé sans qu’il fut perdition. avant que ne fut la nécessaire communication est l’urgence de la présence au phénomène qui requiert l’ouvert à l’instant. […] l’inattendu nous débordant de toutes parts porté de l’éclat, de la clarté et ce qui est dit plans, perceptives, distances, créautions {sic} mentales pulvérisées, hors fonctions. se redresse qui est plane assise. aussi n’est pas qui nous contient comme en lieu clos sécurisé, mais encore à l’ouvert sommes tenus de l’éclat même qui nous fait transgresser le bornage. Pierre Tal-Coat[1] Apparemment peu de ressemblances entre la peinture de Pierre Tal-Coat et celle de Jean-Louis Gerbaud, entre le Breton et l’Auvergnat devenu Bourguignon d’adoption. À bien y regarder, cependant, on découvre une très grande parenté dans l’approche plastique des deux peintres. Tous deux, plutôt que peindre pour produire un tableau, s’intéressent avant tout à la question de savoir comment fonctionne la peinture. Tiraillés entre l’annonce claironnée d’une mort de la peinture, laquelle prend la forme d’une lente agonie, et les voix des sirènes appelant à un retour à un académisme stérile et creux, tous deux cherchent – et trouvent – une ouverture vers une peinture qui se veut avant tout peinture, sans pour autant renoncer au fait pictural, comme d’aucuns l’on fait en ne considérant la peinture que comme un matériau neutre, inerte, plus ou moins malléable, pour servir leur projet de remise en cause du tableau, de la portée mentale et sensible que Léonard de Vinci lui conférait[2]. La primauté de la lumière, le souci du corps-matière de la peinture, de l’épaisseur signifiante de la couche picturale, du dedans de l’œuvre plutôt que de son devant ou de son arrière, la volonté d’ouvrir l’espace, de transgresser le bornage du subjectile, tout en lui composant un cadre pour mieux le déborder, de suggérer un hors-champ rendu prégnant par son absence, l’abandon de la perspective illusionniste et des autres ficelles de la composition au profit de l’urgence de fixer la fugacité d’un phénomène qui n’est qu’éclat, couleur et lumière… Toutes ces préoccupations et ces recherches sont communes aux deux peintres. Chez Gerbaud, comme chez Tal-Coat, le subjectile devient le lieu fabuleux où se déroule une bataille dont l’enjeu est la rencontre du peintre – et, par conséquent, du regardeur – avec la matérialité des choses. Le premier, contrairement au Breton qui utilise des supports opaques (toile, bois, papier…), recourt, depuis plusieurs années, à des planches transparentes en méthacrylate qu’il peint à la gomme-laque sur l’une ou l’autre face, parfois sur les deux. Il les juxtapose ensuite, quelquefois les superpose, pour réaliser des compositions qui jouent simultanément sur la transparence du matériau et sur l’opacité de ce qui est posé dessus. La notion de dessus est d’ailleurs très relative, puisque la face peinte peut être présentée sur le devant ou tournée vers la paroi, mettant en évidence le dos de la matière picturale. Les pistes sont ainsi brouillées : l’épaisseur est anéantie et le spectateur est contraint de constater que le véritable champ pictural n’est ni de son côté ni de celui du mur, mais au sein même du support, dans cet inframince, terme par lequel Marcel Duchamp désignait une différence ou un intervalle imperceptible, parfois seulement imaginable, entre deux phénomènes[3]. Ce cœur actif, ces entrailles de la peinture deviennent une zone d’investigation (« Je pense qu’au travers de l’inframince, il est possible d’aller de la seconde à la troisième dimension[4]. ») mais aussi, comme l’écrit Henri-Frédéric Amiel, un moyen d’appréhender « la différence entre les choses mêmes et l’idée qu’on s’en faisait[5]. » Le lundi 16 novembre 1885, Stéphane Mallarmé, dans une lettre adressée à Paul Verlaine, insistait sur : « l’explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poète. » C’est aussi l’objectif, le devoir auquel Jean-Louis Gerbaud se plie, non pas par le biais de mots mais par celui de la peinture. Les compositions de notre peintre sont fortement structurées par une trame orthogonale, une grille perceptible ou sous-jacente, à laquelle s’accrochent des pans, des taches, des traînées ou des affleurements de couleurs plus ou moins affirmées. Le propos est serré, cadré, mais sans tension artificielle. En cela, il se rattache à une grande tradition de la peinture française qui, de Nicolas Poussin à Simon Hantaï, en passant par Jean Siméon Chardin, fait que les choses sont posées, plus qu’imposées. Elles semblent l’être à leur juste place, comme dans une immuable pérennité. Le propos est serré mais se manifeste – en une épiphanie – avec une désarmante et évidente simplicité, une juste mesure – que l’on pourrait qualifier d’éthique – que le regardeur le moins familier avec les œuvres plastiques ressent spontanément. Quand les lignes horizontales dominent, la composition, on peut y lire un rassemblement d’hirondelles sur des fils télégraphiques, dans un dernier regroupement avant un long vol migrateur. Mais c’est surtout à une partition musicale que l’on est poussé à la comparer, avec ses deux dimensions : mélodie horizontale et harmonie verticale… et la notation de clusters, grappes ou agrégats de sons voisins plutôt que de notes isolées. Jean-Louis Gerbaud travaille d’ailleurs toujours en musique et est familier des écrits de Pierre Boulez. Une autre analogie s’impose aussi, celle avec Le Livre de Mallarmé ou avec la mise en page de son Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897… Absolutisme revendiqué, œuvre d’art totale mais non totalitaire… car, comme l’écrit Umberto Eco, au sujet de cet ouvrage laissé définitivement inachevé : « Dans une telle structure, il était impossible de concevoir un seul passage doté d’un sens défini et univoque, fermé aux influences du contexte ; ç’aurait été bloquer le mécanisme tout entier[6]. » Pas question de bloquer quoi que ce soit, dans les peintures de Jean-Louis Gerbaud qui veut s’ouvrir au monde dans toute son insaisissable diversité, laisser au regardeur la liberté d’y lire ou relire ce qu’il veut… Notre artiste revendique son affiliation dans la descendance de peintres qu’il a découverts lors de sa fréquentation assidue des collections du Louvre pendant ses années d’études aux Beaux-Arts de Paris et qu’il continue à cultiver. La référence à Cézanne, qu’il adule, notamment à sa série de vues de la montagne Sainte-Victoire, est patente dans son économie des couleurs, où tout écart par rapport au spectre de base est hautement signifiant. Matisse a aussi une grande place dans son panthéon en ce qui regarde l’occupation de l’espace pictural et le détail structurant. Il faut l’entendre s’émerveiller du petit triangle plus clair, lumineux, sur le front, masquant l’œil droit du jeune pianiste, dans La leçon de piano, 1916. Les Tabulas, 1972-1982, de Hantaï ne l’ont pas laissé indifférent et l’ont conforté dans son recours à une orthogonalité rigoureuse mais souple pour charpenter ses compositions... La notion de table, de tabulation, voire de tablature, contribue à l’ossature et à l’agencement des pans de méthacrylate dont l’assemblage produit de véritables retables panthéistes…Peut-être aussi, probablement à son corps défendant, faut-il aussi chercher du côté de certains artistes de Supports/Surfaces, notamment de Marc Devade et de Jean-Pierre Pincemin, non pas dans leur rejet du sujet mais dans le souci de mettre en exergue les composantes élémentaires du tableau et les gestes ou processus qui lui donnent naissance… Et tant de peintures encore, observées, analysées, assimilées, comprises, dont il s’est imprégné sans jamais les copier ni les imiter… Le fréquent recours à d’étroites bandes partiellement ou totalement opacifiées, en noir ou en blanc, souvent en bordure des compositions mais parfois en leur centre, nous fait remonter très loin dans l’histoire de la peinture. Les pans horizontaux jouent le rôle de prédelles d’improbables retables. Les verticaux évoquent les colonnes qui jouent un rôle tellement important dans la peinture de la première Renaissance italienne. Je ne peux m’empêcher de faire un rapprochement avec le Saint Sébastien d’Aigueperse, 1480, de Mantegna, conservé au Louvre, dont le sujet aurait été décentré, reporté aux marges. C’est que ces bandes constituent indéniablement un cadre, mais un cadre volontairement incomplet, déconstruit, pour autoriser cette transgression du bornage si chère à Tal-Coat. Cependant, dans ce cadre, aucune place n’est faite pour une représentation illusionniste de l’espace. Pas de recours à la perspective ou à des jeux de couleurs pour suggérer une profondeur ou une troisième dimension, laquelle est toute entière incluse dans la fine épaisseur du subjectile transparent. Alors que ses œuvres peuvent être lues comme des fragments d’une réalité potentiellement illimitée, Jean-Louis Gerbaud ne tombe pas pour autant dans les travers du all-over étasunien. Il y a, dans ses peintures, un espace, physique et mental mais il ne se manifeste que par des dévoilements successifs, laissés à l’initiative du regardeur, qui reconstruit, à sa guise, un monde en trois ou quatre dimensions, dans lequel son esprit peut errer librement. Cette forme de sanctuarisation laïque de l’œuvre, protégée du regard des profanes indiscrets par des voiles comme le naos d’un temple antique, lui confère cette aura lumineuse que portent les anciennes icônes. Mais, attention, pas question d’une velléité de mysticisme. Pour preuve, comme un pied de nez aux amateurs d’idéalisation, Jean-Louis Gerbaud n’hésite pas à donner, dans quelques-unes de ses compositions, une forme sinueuse à la lisière des bandes verticales. Elles affectent alors la forme de certains des stoppages-étalon, 1913, de Duchamp… Un univers bien éloigné du sien mais qu’il a intégré dans son bagage visuel… Paraphrasant Marcel Proust (« Dans une langue que nous savons, nous avons substitué à l’opacité des sons la transparence des idées[7]. »), nous pourrions dire de Jean-Louis Gerbaud que, dans la langue de la peinture qu’il sait fort bien, il a substitué à l’opacité des couleurs la transparence des idées. Ou bien encore, se référant à Mallarmé (« tout, au monde, existe pour aboutir à un livre[8]. ») affirmer que, pour notre peintre, le monde existe pour aboutir à un tableau… Il reste à savoir de quel monde il s’agit : celui des choses visibles ou celui des réalités mentales. La question reste ouverte… béante… Une béance dans laquelle nous prenons le risque, à notre corps défendant, de nous laisser engloutir… Louis Doucet, novembre 2021
[1] Correspondance avec l’auteur du présent texte, 1982.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subjectiles X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son esprit un projet plus vain et plus chimérique, que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de quelque science que ce soit, échapper à toute sorte de critique, et enlever les suffrages de tous ses lecteurs. Jean de La Bruyère[1] C’est en pleine connaissance de ce propos de La Bruyère que l’auteur poursuit, dans ce dixième volume de Subjectiles, son travail de critique de productions plastiques d’artistes de son temps. Il ne convaincra donc pas tout le monde et fera l’objet de reproches mais c’est le prix à payer pour faire entendre une voix dans le consensus mou qui prévaut aujourd’hui. Il a, depuis longtemps, milité pour une critique subjective, ce qui lui permet de ne pas tomber dans l’écueil mis en avant par le même La Bruyère : « Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touchés de très belles choses. » [2] C’est justement parce qu’il est vivement touché par la production de certains plasticiens, jeunes ou confirmés, qu’il éprouve le besoin d’en parler, d’exprimer son point de vue sans vouloir l’imposer comme une lecture univoque, mais avec l’espoir de susciter, chez certains de ses lecteurs, l’envie de procéder à leur propre lecture. Car il s’agit bien d’une lecture, comme Roland Barthes le souligne : « […], la critique est une lecture profonde (ou mieux encore : profilée), elle découvre dans l’œuvre un certain intelligible, et en cela, il est vrai, elle déchiffre et participe d’une interprétation. Pourtant ce qu’elle dévoile ne peut être un signifié (car ce signifié recule sans cesse jusqu’au vide du sujet), mais seulement des chaînes de symboles, des homologies de rapports : le sens qu’elle donne de plein droit à l’œuvre n’est finalement qu’une nouvelle efflorescence des symboles qui font l’œuvre. »[3] Lecture profilée, efflorescences de symboles, quête d’un intelligible qui fait tant défaut dans la critique institutionnalisée qui nous inonde, tels sont les mots-clés qui irriguent et nourrissent les textes qui suivent. Ils ont été écrits en période de confinements successifs, plus ou moins stricts, mais qui ont réduit ou rendu impossible le face-à-face indispensable avec les œuvres. D’un certain point de vue, l’auteur s’est ainsi trouvé dans la situation qu’évoque Paul Éluard dans ces vers dédiés à Guillevic : Cette menace d’impuissance, l’auteur la ressent profondément, il la redoute même, avant de se lancer dans la rédaction d’un nouveau texte, de défendre les travaux d’un nouveau plasticien. Elle l’accompagne dans l’écriture de chaque mot, de chaque ligne, de chaque paragraphe… Mais la volonté d’être avec lui-même lui permet de la surmonter, de se recentrer sur l’essentiel : le rapport du regardeur à l’œuvre. En effet, le critique d’art – beaucoup d’entre eux l’ont bien oublié – n’est, avant toute chose, qu’un regardeur parmi d’autres... En aucun cas un professeur, un thuriféraire ou un censeur… D’où cette indispensable humilité, ce refus de vouloir normaliser, de tenir à faire entrer un travail dans un moule conceptuel ou esthétique préconçu, qui devraient prévaloir dans toute véritable démarche critique. Partir de cette feuille blanche qui donne le vertige à Éluard. Que reste-t-il alors ? Le seul désir – c’est bien ici le mot qui convient – de faire entrer le spectateur dans une démarche l’incitant à sortir d’un terrain connu, à abandonner préconceptions, préjugés et références esthétiques ou morales, pour ne s’en tenir qu’à sa propre lecture, violemment subjective, de ce que l’artiste veut donner à voir. Puissent ces quelques pages contribuer à cet objectif salutaire… Louis Doucet, Hillion, le 15 février 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelques acquisitions récentes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Annonces
|
Espace d’art Chaillioux Fresnes 94
|
du 12 mars au 30 avril 2022 D’ici de là…
|
du 21 mai au 16 juillet 2022 Dessins II
|
du 10 septembre au 29 octobre 2022 À fleur de peau
|
du 12 novembre au 17 décembre 2022 Chaos
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2022
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre
–
Ne plus recevoir la lettre