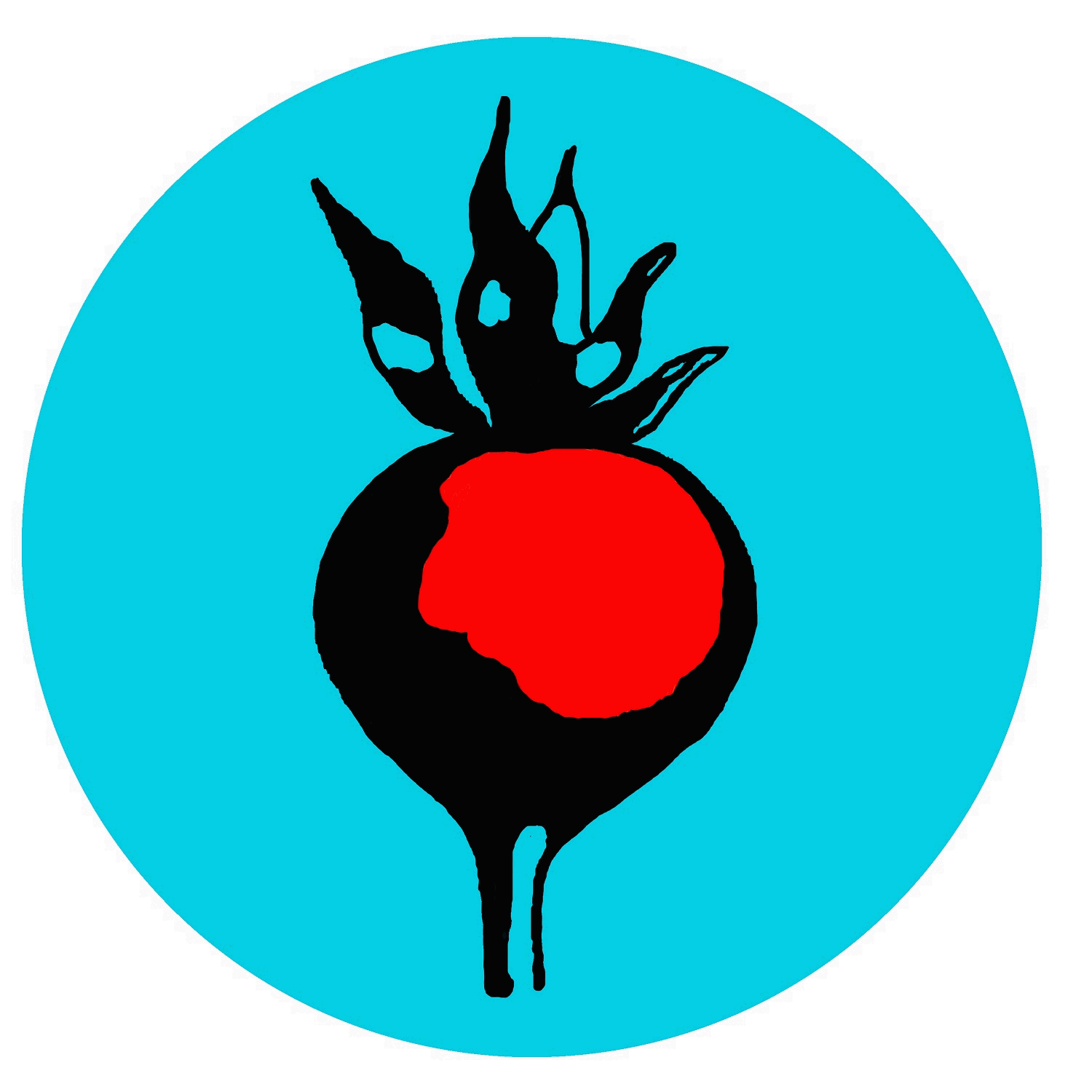|
Le poil à gratter…
|
|
Julia Dupont |
||||
|
|
[…] la photographie n’est ni une peinture, ni… une photographie ; elle est un Texte, c’est-à-dire une méditation complexe, extrêmement complexe, sur le sens. Roland Barthes[1] C’est en effet une autre nature qui parle à l’appareil photo que celle qui parle à l’œil ; différente surtout en ce sens qu’à un espace imprégné de conscience par l’homme se substitue un espace imprégné d’inconscience. Walter Benjamin[2] Julia Dupont est une artiste et photographe française avec des origines portugaises. Elle travaille en Seine-et-Marne, à Paris et au Portugal, voyageant aussi un peu partout dans le monde pour y collecter des images qui l’inspirent. Elle s’intéresse indifféremment aux paysages, aux architectures, aux artefacts humains ou aux manifestations normales ou accidentelles de la Nature. Dans tous les cas, elle les traite comme des projections matérielles d’un monde intérieur[3], comme des témoignages d’une pensée structurante, la sienne mais aussi et surtout de celles et de ceux qui les ont élaborés, transformés ou simplement côtoyés à travers les âges. Elle les imprègne de cette conscience évoquée par Walter Benjamin dans la citation en exergue au présent texte. Elle procède, le plus souvent, par séries thématiques, ponctuelles, étalées dans le temps ou sous forme de work in progress. J’ai découvert son travail en 2020, lors de son exposition à la Galerie du Haut-Pavé, où elle présentait des tirages sous le titre Épure, 2016-2018. Les photographies de cette série sont celles du site d’un ancien couvent franciscain, désaffecté depuis près de deux siècles, dans la montagne de Sintra, au Portugal. Les images que Julia Dupont en donne sont d’un grand dépouillement, ascétique même, dans leur minéralité. Elles sont hantées par l’absence physique de tout personnage à laquelle se substitue, cependant, la sensation d’une présence humaine qui demeure latente, une caractéristique qui irrigue toute l’œuvre de Julia Dupont. Peut-être faut-il y voir une forme d’exutoire, du type de celui que Franz Kafka évoque : « On photographie les objets pour les chasser de son esprit[4]. » Dans ces œuvres, comme dans toutes celles qui suivront, la dimension temporelle est prégnante, perçue comme un manque qui sollicite une réaction du regardeur. Jamais l’indifférence… La lumière y joue un rôle primordial, simplifiant les formes données à voir, au point, dans certains tirages, de les rendre quasiment abstraites, comme une épure d’architecte, de les plonger dans un silence qui ne peut qu’interroger le spectateur. De ce silence Sandra Silva écrira, en 2023 : « il nous réconforte en nous fixant sur le détail, face à l’agitation de la vie quotidienne qui nous met dans un état d’inattention quasi perpétuel comme il nous berce dans un état d’agitation grâce à l’image codée[5]. » L’artiste nous invite ainsi à une déambulation personnelle au sein de ces espaces longtemps habités dont l’histoire de ses anciens occupants resurgit, çà et là, à travers un détail anodin. Intérieur et extérieur s’interpénètrent dans un exercice de projection mentale qui confère à la nature environnante une dimension architecturale, prolongeant celle des murs décrépis de l’intérieur des bâtiments. La démarche de Julia Dupont s’inscrit ainsi pleinement dans la dimension scripturale évoquée par Roland Barthes dans la citation en tête de ces notes. Faut-il le mentionner, notre artiste a aussi des dons littéraires. Elle intègre ainsi à sa série un ensemble de trente-huit poèmes et de quatre textes anciens, comme celui-ci, intitulé Épure, poème # 3 :
Dans ces vers libres, s’établit une fructueuse ambiguïté, une forme d’effet-miroir, entre sujet et objet. C’est la photographe qui est à l’arrêt, bien que le rouge-gorge le soit aussi, sur un qui-vive indispensable à sa survie. Le je n’est pas énoncé. Il est juste suggéré par la forme féminine du mot fascinée. On observe ici, comme dans les autres photographies de Julia Dupont, une certaine distanciation, probablement difficilement consentie, un lâcher-prise que l’on devine à contrecœur, pour laisser la place à des tiers : les deux visiteurs intrus dans le poème, le regardeur dans les photographies. On ne peut s’empêcher de penser au propos d’un autre photographe, Édouard Boubat qui disait : « Les photos que nous aimons ont été faites quand le photographe a su s’effacer. S’il y avait un mode d’emploi, ce serait certainement celui-là[6]. » C’est ce discret et délicat – presque douloureux me semble-t-il – effacement du je qui contribue au mystère de la plupart des travaux de Julia Dupont. Mon deuxième contact avec les œuvres de Julia Dupont a été, un peu plus tard, avec sa série Surfaces profondes, commencée en 2014. Cet ensemble, toujours en cours, traite de la perception de l’espace et de la lumière en se focalisant sur des détails architecturaux, souvent isolés de leur contexte, dont on a parfois du mal à identifier la nature. L’orthogonalité des espaces géométriques – ou géométrisés par le cadrage –, incisif ou flou, est de rigueur. Elle est accentuée par une lumière qui élimine relief et profondeur pour conférer aux images une planéité qui incite le spectateur à pousser des portes, réelles ou fantasmées, à la recherche d’un derrière de ce qui est représenté, d’un sens occulté. Pour la photographe, ce sont des espaces transformés en surfaces, lesquelles, dans un palindromique effet de miroir, deviennent ces surfaces profondes pour le regardeur. La question se pose de savoir si la forme apparente, signifiante, que l’on identifie ou imagine, a un rapport avec une réalité tangible ou supposée. Une fois de plus, nous sommes, ici encore, très proches des réflexions de Roland Barthes sur la photographie, quand, mettant en parallèle le travail de l’écrivain et du photographe, il écrit : « La photo, c’est comme le mot : une forme qui veut tout de suite dire quelque chose. […] Rien à faire : je suis contraint d’aller au sens – du moins à un sens. Le statut de ces systèmes est paradoxal : la forme ne se pose que pour s’absenter au profit d’un réel supposé : celui de la chose dite ou de la chose représentée[7]. » Tous les travaux de Julia Dupont ont une évidente dimension mémorielle et, ce, à au moins deux titres. Ils sont simultanément diachroniques et synchroniques[8]. Tout d’abord, au moment de la prise de vue, ils résument, en un nombre limité d’images fixes, toute la profondeur, l’épaisseur temporelle de l’histoire – des faisceaux d’histoires – des générations qui ont créé, animé et fabriqué les lieux qu’elle investigue. Mais dans le même geste, ils témoignent du hic et nunc de la photographe en train de coaguler ses propres sentiments lorsqu’elle fige, une fois pour toutes, ses affects. Ce sont des sortes d’arrêts sur image qui solidifient des expériences profondément vécues et intégrées, bien plus que ne le feraient des images mouvantes. Milan Kundera l’a bien compris, quand il écrit : « La mémoire ne filme pas, la mémoire photographie[9]. » Plus généralement, notre artiste pose la question du statut de la photographie et de son supposé réalisme. Baudelaire, déjà, au début de l’essor de cette technique, déclarait, non sans ironie, dans un passage que je ne résiste pas à citer in extenso : « Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l’esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d’elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du monde, surtout en France (et je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire), est celui-ci : Je crois à la nature et je ne crois qu’à la nature (il y a de bonnes raisons pour cela). Je crois que l’art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette). Ainsi l’industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l’art absolu. Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit : Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d’exactitude (ils croient cela, les insensés !), l’art, c’est la photographie[10]. » Le réalisme et l’exactitude – pour reprendre les mots de Baudelaire – de Julia Dupont sont de type anthropologique mais, paradoxalement, d’une anthropologie dans laquelle l’homme est occulté et n’apparaît qu’à travers des traces, sensibles ou immatérielles, d’une oxymorique existence absente ressentie comme une lacune dans le continuum de la narration. À l’instar de Cuvier reconstituant le régime alimentaire des dinosaures à partir de quelques-uns de leurs ossements fossilisés, Julia Dupont recrée des univers passés à partir de quelques indices mémoriels – des fossiles, à leur façon – négligés. Elle se comporte, en quelque sorte, en paléontologue de l’anthropocène… Déjà, dans les dix photographies de la série La dalle, 2011, elle revisitait l’architecture urbaine des années 1960-1970, telle qu’elle se manifeste sur les dalles des quartiers de Beaugrenelle et des Olympiades à Paris. Aucune présence humaine détectable, comme à son habitude, mais un découpage au scalpel des options d’une esthétique architecturale affirmée, non dénuée, à l’origine, d’un certain utopisme qui paraît désormais bien désuet. Elle posait, en creux, la question de savoir comment les habitants de ces quartiers peuvent y vivre, y habiter, réussir à humaniser, par leur présence – en manque sur ses clichés –, ces espaces déshumanisés, remplir cette angoissante et étrange vacuité… Pourtant faite par l’homme pour l’homme… La même année, les vingt-trois tirages de la série Im Wald, se présentaient comme un reportage des conditions de vie d’un couple d’Allemands, totalement absents dans les images. Julia Dupont écrivait, à leur sujet : « Je souhaitais construire une histoire à partir de leur existence, de leur isolement, de la façon de vivre qu’ils avaient développée et de l’espace qu’ils avaient ainsi créé. À la fois artistes, poètes et musiciens, leur maison est habitée de leurs créations, iconographiques, sculpturales, littéraires […] et leur sensibilité s’exprime dans chaque chose, visible ou invisible. Les objets et scènes représentées dans mes images, cherchent à transmettre et à susciter l’imagination du spectateur sur la singularité de leurs pensées, de leurs positions et de leurs actes matérialisés dans leur foyer et dans la forêt au milieu de laquelle leur maison se trouve[11]. » Ce work in progress s’est mué en un ensemble dans lequel les photographies sont accompagnées d’éléments textuels : fragments de récits ou de correspondance, courts poèmes… Un peu à la façon dont, dans une thèse universitaire, les documents annexes viennent corroborer des positions défendues dans le corps du mémoire. Plus récemment, Rémanence, 2012-2013, se présente comme un livre en exemplaire unique composé de trente-trois photographies réalisées par l’artiste et de trente autres, les seules où figurent des personnes, provenant d’archives et témoignages familiaux. Cette famille, c’est celle des deux frères Alphonse et Raymond Réthoré, créateurs, entre 1940 et 1980, du château inachevé de la Mercerie à Magnac-Lavalette-Villars, dans le département de la Charente. À leur décès, le mobilier de la demeure fut éparpillé et les bâtiments laissés à l’abandon. Sorte de constat d’enquête, avec ses pièces justificatives, cet ensemble redonne vie, réanime un récit marqué par la notion d’incomplétude, celui de la bâtisse, mais aussi celui du reportage, d’une tentative de redonner un sens aux éléments subsistants qui pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. C’est, selon les mots de l’artiste, le récit d’une tentative de reconstruction, une hypothèse sur ce lieu[12], mêlant plusieurs temporalités, comme je l’ai déjà souligné au sujet de la plupart des travaux de notre artiste. Les trente-deux photographies et seize textes imprimés sur des grandes bâches de la série La partition du temps, 2022-2023, combinent encore les dimensions textuelles et plastiques. Les images sont celles de l’Abbaye Royale de Saint-Pierre-de-Bourgueil, en Indre-et-Loire, de nouveau une ancienne enceinte monastique, cette fois-ci, non pas abandonnée mais transformée en résidence pour personnes âgées, après avoir servi d’hospice… Ici, pas plus qu’ailleurs, nulle présence physique des occupants, présents ou passés, des lieux mis en scène… Mais des portes, des escaliers, des meubles de rangement, des classeurs, des armoires, tous objets fonctionnels qui évoquent, à leur façon, la notion d’enfermement ou d’isolement, qu’il soit monacal, médical ou celui de la vieillesse solitaire. Situations volontaires ou contraintes, mais évocatrices d’une intériorisation nécessaire pour échapper à un monde dans lequel les choses, physiques, mentales et morales, sont rangées, normées, ordonnancées, inexorablement soumises à d’inflexibles règles… Silence et lumière irriguent les photographies, métaphores des états d’esprit supposés des générations qui se sont succédé dans ces murs, sacrées ou profanes… Un travail d’archéologie de la mémoire condensant en un seul plan de multiples strates temporelles… Profondeur et planéité, encore et toujours… La plupart des caractéristiques que j’ai évoquées me semblent se cristalliser dans la dernière série, Geometrias do Ó, de Julia Dupont, hommage au cercle ou à la sphère, formes primordiales entre toutes. Peut-être un pied-de-nez à la rigueur sérielle des Hommages au carré de Josef Albers ? Ces rotondités peuvent être planes ou en relief, naturelles ou fabriquées, proches ou lointaines, saisies en atelier ou en plein air, de petites dimensions ou immenses, végétales ou minérales, facilement identifiables ou indéterminables. L’artiste déclare à leur sujet : « Ces éléments apparemment disparates se trouvent associés entre eux, comme des voix distinctes à l’intérieur d’une partition musicale, poursuivant ce même thème : l’expression du cercle. Celui-ci souligne diversement des valeurs d’abri, de matrice, de repli, d’intériorité, de potentiel de création[13]. » Tout est dit… Louis Doucet, juillet-août 2024
[1] Tels (sur quelques portraits de Richard Avedon), in Photo n° 112, janvier 1977.
|
|||
|
Claire-Rose Barbier |
||||
|
Claire-Rose Barbier est une artiste polymorphe, plasticienne, musicienne, circassienne, chanteuse lyrique et populaire, écrivaine… Dans ces pages d’un érotisme à fleur de peau, elle entrelace des temporalités et des lieux différents, des expériences vécues ou fantasmées, des gestes affirmés et une forme de résignation ou de passivité. Elle révèle ainsi, avec intelligence, sensibilité et discrétion, des aspects trop peu souvent évoqués du sujet, devenu tabou, qu’est le désir féminin.
Les tentacules d’une pieuvre omniprésente, suggestive d’étreintes aussi charnelles que mentales, accompagnent cette déambulation qui imbrique le monde extérieur d’une Nature qu’elle observe avec finesse et celui de sa propre intériorité. |
||||
|
Quelques acquisitions récentes |
||||
|
Annonces |
|||||
|
Espace d’art Chaillioux Fresnes 94
|
|||||
|
du 11 janvier au 22 mars 2025
On découpe…
|
|||||
|
du 5 avril au 7 juin 2025
La saison du dessin
|
|||||
|
du 14 juin au 26 juillet 2025
Vas-y raconte…
|
|||||
|
du 13 septembre au 20 décembre 2025
Recycle Art
|
|||||
|
|
Cynorrhodon - FALDAC recommande | ||||
|
Noël Dolla Tarlatane et Snipers du 14 décembre 2024 au 22 mars 2025 Galerie Réjane Louin – 19 rue de l’Église – 29241 LOCQUIREC |
|||||
|
Germain Marguillard Everything we touch can change Sarah Van Melick Mémoires en dormance du 8 janvier au 15 mars 2025 L’H du Siège – 59300 VALENCIENNES
|
|
macparis Printemps 2025 |
du 20 au 25 mai 2025 Bastille Design Center – 74 boulevard Richard-Lenoir – 75011 PARIS | ||
Les anciens numéros sont disponibles ICI
© Cynorrhodon – FALDAC, 2025
Association sans but lucratif (loi de 1901) – RNA W751216529 – SIRET 78866740000014
33 rue de Turin – 75008 PARIS – webmaster@cynorrhodon.org – www.cynorrhodon.org
Recevoir la lettre
–
Ne plus recevoir la lettre